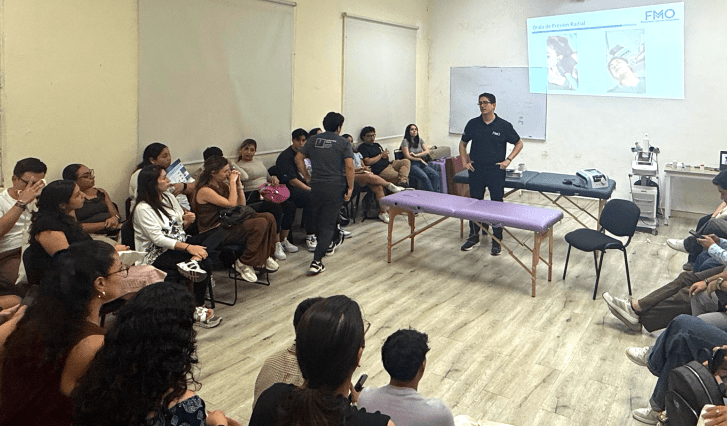« Le plus grand défi en matière de santé sexuelle et reproductive en Colombie reste d'atteindre tous les territoires », déclare Marta Royo, directrice générale de Profamilia.

Bogotá a accueilli la Conférence internationale sur la planification familiale (ICFP), une plateforme et un mouvement mondial réunissant divers acteurs pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Cette conférence a rassemblé des gouvernements locaux et internationaux, des fondations, des universités et des organisations internationales . Elle s'est déroulée dans un contexte de sous-financement chronique sans précédent pour ce domaine, avec un déficit estimé à 1,5 milliard de dollars d'ici 2030.
EL TIEMPO s'est entretenu avec Marta Royo, directrice générale de Profamilia — l'une des organisations hôtes — au sujet de ce que représente ce retrait de financement pour la Colombie, des défis à relever pour garantir l'accès à l'information et aux méthodes contraceptives, et des facteurs qui rendent encore difficile l'accès à l'interruption volontaire de grossesse à un coût abordable sur l'ensemble du territoire du pays.
Que signifie cet événement, et quelles sont les implications de sa tenue pour la première fois ici en Colombie ?
Marta Royo lors d'une conférence à l'ICFP. Photo : Courtoisie de Profamilia
Cet événement est le plus important au niveau mondial sur la question des droits sexuels et reproductifs , car il réunit le monde universitaire, la communauté scientifique, le secteur médical, les mouvements et organisations de la société civile, les ONG, les agences de coopération, les donateurs… tous ces acteurs qui se concentrent sur la discussion des progrès accomplis et des défis à relever au niveau mondial du point de vue des droits sexuels et reproductifs.
Plus de 3 600 personnes, dont plus de 600 jeunes venus de différents pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du monde arabe : voilà ce qu’a représenté cette conférence. Et qu’est-ce que cela signifie pour la Colombie ? Une occasion extraordinaire, celle de montrer comment, malgré d’énormes difficultés, ce pays a su mettre en œuvre un programme très ambitieux en matière de droits sexuels et reproductifs. Nous disposons d’un cadre juridique solide.
Je pense donc que c'était l'occasion pour la Colombie de se mettre en valeur, de démontrer son expertise médicale, scientifique, de plaidoyer et éducative… et de remporter un franc succès. C'est la première fois que cette conférence se tient dans un pays d'Amérique latine.
Comment la Colombie gère-t-elle le sous-financement de la santé sexuelle et reproductive, et pourquoi cela se produit-il ? Il existe de nombreux facteurs. Le système de santé rencontre des difficultés, la violence sévit sur notre territoire, et un problème culturel, associé à une stigmatisation, alimente la désinformation et rend l'accès aux services et à l'information plus difficile pour les jeunes. Par ailleurs, de nombreux aspects liés aux droits sociaux et reproductifs ont été progressivement retirés des programmes de coopération internationale. Nous avons constaté la disparition des programmes de diversité, d'égalité et d'équité, situation aggravée par le démantèlement de l'USAID.
Les droits reproductifs nous concernent tous et toutes, et personne n'est épargné. Nous traversons actuellement une crise de coopération, et la Colombie, qui figurait parmi les pays bénéficiant le plus de l'aide internationale, en subira les conséquences.
Quel est selon vous le plus grand défi auquel la Colombie est confrontée aujourd'hui en matière de santé sexuelle et reproductive ? Le premier défi, sans aucun doute, est la couverture. En Colombie, de nombreuses zones restent difficiles d'accès. Nous essayons de les atteindre grâce à 4 000 brigades mobiles par an, mais c'est trop coûteux, et pas seulement financièrement : nos équipes doivent se déplacer à dos de mule ou à pied. Il est donc difficile d'offrir dans ces territoires les mêmes services que dans une ville comme Bogotá. Un autre défi est celui de la violence et des grossesses adolescentes. Le dernier grand défi est d'informer l'ensemble de la population afin que les jeunes connaissent leurs droits, comment accéder à la contraception ou à une interruption volontaire de grossesse.
En Colombie, l'accès aux contraceptifs reste inégal. Quels facteurs empêchent le pays de garantir un accès réel ? En Colombie, nous proposons toute la gamme. Des génériques aux contraceptifs de marque : méthodes à action prolongée, à action moyenne, injectables, hormonales … nous avons accès à tout. Le problème, c’est que l’accès à ces produits est difficile dans de nombreuses régions.
Lorsqu'elles arrivent enfin, les femmes reçoivent souvent une méthode contraceptive qui n'est pas celle dont elles ont besoin. Par conséquent, on constate fréquemment un manque de cohérence dans la mise à disposition de la méthode contraceptive réellement adaptée , ainsi que des difficultés à obtenir un rendez-vous médical.
Du point de vue de Profamilia, comment évaluez-vous la mise en œuvre de la loi C-055 (qui a dépénalisé l'avortement jusqu'à la 24e semaine) ? Quels sont les obstacles les plus persistants ? Cette décision est extraordinaire. Elle garantit aux femmes l'accès à des services d'avortement sûrs, de qualité, rapides et accompagnés, et surtout : sans aucune sanction.
Mais cela a aussi mis en lumière les lacunes du système. Le défi consiste notamment à former davantage de personnel. L'objectif est qu'aujourd'hui, dans chaque municipalité de Colombie, on puisse trouver au moins un prestataire de services formé et capable d'assurer ce service.
Il existe encore des établissements de santé (cliniques et hôpitaux) qui s'arrogent le droit de refuser des soins aux femmes et omettent de leur expliquer les options disponibles pour une interruption volontaire de grossesse. Ces établissements ne font qu'entraver et retarder l'accès aux services.
Quel est l’état actuel de l’accès aux méthodes contraceptives pour la population migrante ? Il existe de nombreux programmes destinés aux populations migrantes. J'estime que le gouvernement a déployé des efforts considérables pour permettre aux migrants de s'enregistrer, d'obtenir tous les permis de voyage nécessaires et d'accéder aux services. Cependant, cette population, très mobile, se déplace constamment et ne se sédentare pas, ce qui la rend vulnérable au risque d'exclusion. Malgré tout, nous bénéficions d'une couverture complète, nous sommes intégrés au système de santé et notre accès aux soins est supérieur à celui des autres pays de la région. Il subsiste néanmoins des zones très difficiles d'accès que nous nous efforçons d'atteindre grâce à des équipes mobiles de santé.
Quel est le rôle de l'innovation technologique dans la réduction des inégalités pour les femmes rurales ? Je tiens à souligner une fois de plus l'importance de l'information. Aujourd'hui, nous sommes des êtres numériques, accédant constamment aux données via nos tablettes et nos téléphones. Il est donc impératif de poursuivre nos efforts pour garantir la qualité de l'information diffusée en ligne.
J'ajouterais qu'il nous faut innover, notamment dans le domaine de la télémédecine. Je pense que nous pouvons atteindre de nombreuses zones rurales grâce à un modèle de téléconsultations et d'envoi d'images diagnostiques. Il existe d'innombrables outils performants : numérisation des dossiers médicaux, accessibilité, enregistrement des informations et compilation des statistiques issues des équipes mobiles.
Existe-t-il des données actuelles sur les maladies sexuellement transmissibles qui devraient inquiéter le pays ? Nous attendons la publication de l'Enquête nationale démographique et de santé pour obtenir des chiffres plus précis. Chez Profamilia, nous constatons une augmentation du nombre de tests positifs, mais cela pourrait être dû à un meilleur accès aux tests ou à des difficultés d'accès à des informations fiables sur la transmission des IST.
Mon invitation est que nous continuions à travailler et à nous engager en faveur de la défense des droits sociaux et reproductifs , que les gens soient bien informés, qu'ils utilisent des mécanismes d'information corrects, opportuns et de qualité et qu'ils prennent leurs décisions en fonction de cela, et non de ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux.
eltiempo